Faculté de Pharmacie de Paris

La Société d’histoire de la Pharmacie et la Société des Amis du Musée François TILLEQUIN vous invitent à une journée de conférences sur le thème des jardins coloniaux.
Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 14 h en salle des Actes.

© SHP
Programme
- 14 h – Introduction
Bruno Bonnemain, Société d’Histoire de la Pharmacie (S.H.P) et Sylvie Michel, Société des Amis du Musée François TILLEQUIN.
- 14 h 10 – Jardins botaniques
Michel Botineau, Professeur émérite de botanique, faculté de pharmacie de Limoges, administrateur Société botanique de France. Créateur d’un jardin médiéval et auteur d’un ouvrage sur les plantes du jardin médiéval.
Faisant partie de la vie spirituelle du monastère, les jardins médiévaux peuvent être définis à la fois par leur architecture et leur structure, nous renvoyant aux relations symboliques – voire magiques – des hommes de cette époque avec les plantes. Mais il y avait plusieurs types de jardins : on distinguait l’hortus ou potager pour s’alimenter contenant des potherbes ou des légumes parfois oubliés de nos jours , le viridarium ou verger-cimetière qui était également un lieu de recueillement avec les fruitiers introduits entre les tombes, l’herbularium ou jardin des simples situé à proximité de l’in irmerie rassemblant des espèces liées aux «signatures», et en in le jardin de Marie permettant la cueillette de leurs qui rythmait les fêtes liturgiques de ses o randes de bouquets. Il pouvait s’y ajouter des espaces pour des plantes utilitaires – tinctoriales en particulier – sans oublier les treilles aux multiples usages.
- 14 h 45 – Plantes impériales, une histoire des jardins botaniques et jardins d’essais coloniaux,
Hélène Blais, Professeure d’histoire contemporaine à l’École normale supérieure (Paris) et membre de l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine.
Quel rôle ont joué les jardins botaniques et les plantes qui y sont cultivées dans la constitution des empires coloniaux ? Au XIXe siècle, chaque colonie européenne avait son jardin botanique. Ces lieux ont été façonnés par les ambitions impériales, qu’ils ont en retour contribué à porter. Les jardins sont de lieux qui révèlent beaucoup du fonctionnement quotidien du système colonial : décors de promenade pour la société européenne, lieux de savoirs – et de captations de savoirs, terrains d’acclimatation et de reproduction des plantes, ce sont aussi des lieux de travail contraint, qui mettent au jour les tensions inhérentes à la situation coloniale.
- 15 h 30 – Le jardin botanique de Calcutta, XIXe siècle : conserver, converser,
Marine Bellego, Maîtresse de conférences à l’université Paris Cité, membre du LARCA (Laboratoire de recherche sur les cultures anglophones, UMR 8225)
Créé à la fin du XVIIIe siècle par la East India Company, le jardin botanique de Calcutta devint au XIXe siècle un vaste centre d’acclimatation et de classification d’espèces végétales. Financé par l’empire britannique, dont Calcutta demeura la capitale indienne jusqu’en 1911, le jardin contribuait à la fois économiquement et symboliquement au dispositif impérial. Les plantes, spécimens et publications qu’il produisait alimentaient le fonctionnement à la fois matériel et discursif d’un pouvoir qui se présentait comme global, bienfaisant et inspiré par des principes scienti iques, en dépit des nombreux échecs et dysfonctionnements qui ponctuaient la vie du jardin comme celle de l’empire. Vitrine de la mission civilisatrice coloniale, le jardin botanique de Calcutta était un lieu où conservation et conversation allaient de pair : la conservation des spécimens et de la mémoire du lieu même du jardin n’avaient de sens que par une mise en conversation des objets scientifiques avec ceux d’autres institutions. Enclave locale de nature ordonnée et institution à prétention globale, telle était l’une des contradictions du jardin botanique.
- 16 h 15 – Le Jardin d’agronomie tropicale « René Dumont » de Paris, ancien Jardin colonial : Évolution de ses missions jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale (1899-1939),
Dominique Lasserre, Chargé de ressources documentaires patrimoniales, Délégation à l’information scienti ique et à la science ouverte, Cirad
Le Jardin colonial de Nogent-sur-Marne a été créé en 1899 sous le nom de Jardin d’essai colonial, dans le but de contribuer au développement de la production dans les colonies françaises de plantes dites « utiles ». Appelé à fonctionner comme un jardin d’essai métropolitain et une tête de réseau des jardins d’essai des colonies, les quarante premières années de son histoire illustrent un enchevêtrement de missions. Cette intervention s’attachera à présenter la multiplicité des activités du Jardin colonial, de l’analyse, la multiplication et l’expédition de végétaux tropicaux à la formation d’agronomes coloniaux, en passant par l’organisation d’expositions coloniales et l’accueil de blessés originaires des colonies durant la Première Guerre mondiale. Seront restituées les informations que donnent les rapports d’activité des jardins d’essai coloniaux en Afrique et à Madagascar sur leurs échanges, de plants et semences et de savoir-faire, avec le Jardin de Nogent.
À lire aussi

Rencontre avec Hélène Louys qui a suivi le DU Auditeur qualité dans l’industrie du médicament
Nous avons rencontré Hélène Louys, avocate, docteur en pharmacie et diplômée de l’Université Paris Cité, qui a suivi le Diplôme Universitaire “Auditeur qualité dans l’industrie du médicament” à la faculté de pharmacie de Paris.Elle nous raconte son...

Journée Portes Ouvertes 2026
La Faculté de Pharmacie de Paris organisera sa Journée Portes Ouvertes le dimanche 8 février 2026 au 4 avenue de l’Observatoire

Paris et Toronto resserrent leurs liens en pharmacie
La Faculté de Pharmacie de Paris a récemment accueilli le Pr Reina Bendayan, éminente chercheuse de la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto, consolidant ainsi un partenariat entre les deux institutions. Invitée par le Pr Xavier...
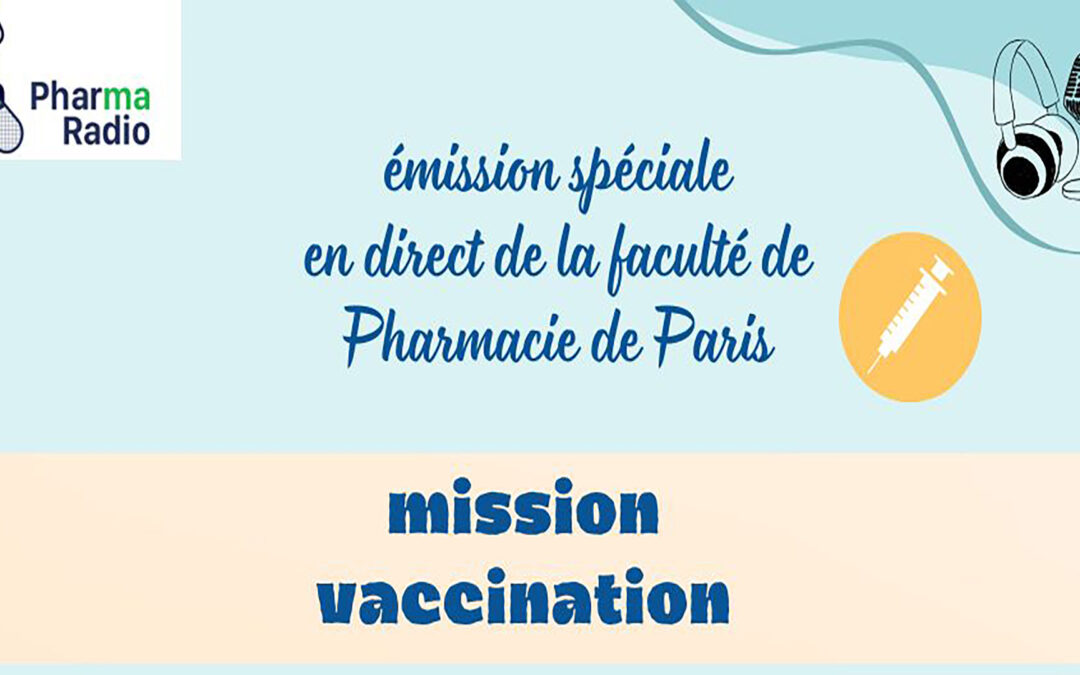
PharmaRadio à la faculté de Pharmacie de Paris
Le 8 octobre dernier, la Faculté de pharmacie de Paris a accueilli l'équipe de Pharmaradio qui, en association avec l’Académie nationale de Pharmacie, a diffusé une émission exceptionnelle consacrée à la vaccination « Mission vaccination », en direct du...
